Avant propos : un faux souvenir. Dans un article, publié il y a plus de douze ans (Radiszcz, 2005), nous avons abordé le film Un Chien Andalou (Buñuel, 1929) pour explorer la production de « l’inconscient optique » dont Walter Benjamin (1955[1939]) avait observé les opérations métamorphiques de la caméra dans le cinéma. À l’époque, il s’agissait bien d’indiquer que la composition de l’espace cinématographique ne pouvait pas se réduire à la seule perception visuelle des images ou d’une succession d’images. Au fond, il ne fallait surtout pas négliger la portée décisive du traitement filmique qui, accompli dans les images, avec les images, par les images et, notamment, entre les images, participe à la configuration du champ scopique où la division du sujet relève de sa rencontre avec le regard [1] . L. Buñuel, Un chien Andalou, 1929 En ce sens, le prologue et l’épilogue du petit film de Luis Buñuel montrent, magistralement à nos yeux, l’incidence fondamentale que les opérations filmiques de coupure et de montage ont sur la dimension scopique du vecteur subjectif dans le plan géométral. Par des articulations diverses obtenues selon des modalités variables, ces procédés comporteraient une scission de l’œil filmique qui, réparti entre la caméra et le spectateur, préside la percée d’un espace cinématographique où advient l’objet scopique qu’y circule non pas tant dans l’image sinon plutôt parmi les images. Ainsi, la véritable matière filmique ne serait donc pas à chercher du côté de la visibilité fournie par les images, mais à trouver dans l’invisible d’un réel rencontré entre les interstices des images dont Un Chien Andalou donne bien sa métaphore par l’humeur vitrée qui jaillit de l’œil fendu par le réalisateur lui-même. L. Buñuel, Un chien andalou, 1929 À présent, cette contribution compte alors prolonger ces idées à partir d’une piste qui, laissée auparavant suspendue à une brève indication de quelques lignes, vise à problématiser la relation entre le cinéma et le rêve. Il s’agit, bien entendu, d’un rapport maintes fois avancé, notamment parmi les psychanalystes [2] mais pas uniquement par eux [3]. Pourtant, c’est un lien qui, en raison de la massivité presque naïve dont – encore des nos jours – il s’avère trop fréquemment posé [4], reste à tel point suspect que, à son propos, il m’est venu à l’esprit un drôle de souvenir à vous confier. En effet, j’ai eu le souvenir, clair et précis, d’avoir lu (ou écouté) l’affirmation la plus nette qui, soutenue par un reconnu réalisateur, formulait l’impossibilité absolue de filmer un rêve. Le problème est que je n’ai pas la moindre idée de qui aurait pu dire chose pareille ! J’ai parcouru les textes. J’ai relu les théoriciens et les historiens du cinéma. J’ai cherché chez les réalisateurs. J’ai demandé à mes amis cinéphiles. J’ai interrogé des spécialistes. Je n’ai pourtant rien trouvé [5]. Est-ce que j’aurais donc rêvé de cette affirmation ? Aurais-je fait un rêve sur l’impossibilité de filmer un rêve ? S’agissait-il, plutôt, d’un souvenir-écran construit à l’instar de la ferme opposition freudienne (Gay, 1988) face aux tentatives de Samuel Goldwyn de mener la psychanalyse à l’écran hollywoodien ? Ou peut-être un faux souvenir édifié sur l’encore plus énergique objection de Freud – « Dumm dinge [fadaises] », avait-il exclamé (1925, p. 68) – – envers la contribution de Karl Abraham et de Hans Sachs (cf. Farges, 1975, pp. 90-91) à la rédaction du scénario de Les Mystères d’une âme tourné, en 1926, par Pabst ? Etait-il alors question, dans cet étonnant souvenir, de la « cinéphobie » freudienne (Michel, 2010-11) que, à la faveur de mon soupçon, j’aurais portée convenablement sur l’ensemble des rêves et des films ? G. W. Pabst, Geheimnisse einer Seele, 1926 Le rêve au cinéma Néanmoins, qu’il soit une fiction onirique ou une fabulation mnésique, le dit souvenir ne semble pas entièrement déroutée. Non pas qu’il n’y ait point des rêves filmés. Il suffit de penser à Spellboum de Hitchcock (1945), Les oubliés de Buñuel (1950) ou Les fraises sauvages de Bergman (1957). En fait, tel que l’indique Lydia Marinelli (2006), depuis son début, le cinéma n’a nullement été avare pour montrer des nombreux rêves à l’écran. C’était bien sûr le cas de Georges Méliès dans Le rêve du maître de ballet (1903) ou Le rêve de l’horloger (1904), mais il a été aussi celui de Edwin S. Porter dans Life of an American Fireman (1903) ou The Dream of a Rarebit Fiend (1906). Pourtant, il paraît très abusif d’affirmer qu’on rêve lorsqu’on voit un rêve filmé et encore plus abusif de soutenir, comme cela a déjà été avancé, que voir un film n’est au fond que faire un rêve ou que rêver ne serait pas autre chose que du cinéma privé. Pour contrarier de telles idées, il suffit de faire le même genre d’exercice que ceux que Wittgenstein (1953) avait l’habitude de faire pour distinguer des expériences selon les particularités des jeux de langages concernés à chaque cas et qu’il a justement fait à propos de l’acte de rêver pour souligner ses différences avec d’autres actions, notamment celles de se souvenir, de s’endormir ou même de regarder (Wittgenstein, 1980). Dans un film, le rêve peut certainement être un matériau de travail, une source d’images, un recours esthétique, un composant diégétique, un opérateur sémantique, une dislocation, une césure, une ruse, une énigme, un caprice… Le rêve peut beau avoir une large place dans un film, mais le rêve d’un film, même s’il est construit avec la plus fine maîtrise des procédés oniriques identifiés par Freud (1900), n’en est pas moins une affaire strictement filmique. Il n’est nullement un rêve, mais un rêve filmé, c’est-à-dire un simulacre ou un artifice mis aux profits du film. De même, rêver d’un film n’a en rigueur rien filmique, mais il relève tout d’abord d’une question proprement onirique. Car si le rêve s’en serve d’un film, cela peut toujours être l’indication que le rêveur, comme on dit, se fait des films ou qu’il en fait tout un cinéma. Le film rêvé n’est pas un film mais le film aux services d’un rêve. De fait, il paraît assez problématique de défendre une parenté fondamentale entre le rêve et le cinéma à partir de leur supposée ressemblance. Ce n’est pas parce que tout les deux aient à faire avec des images ou avec des articulations d’images, qu’il existe un rapport strict entre eux. Ce type d’analogie rapide non seulement oublie qu’on n’a jamais vu un rêve fait par quelqu’un d’autre, car on n’en a toujours que le récit. Mais l’analogie se plie surtout de la manière la plus banale à l’expression trop courante concernant le cinéma comme « usine de rêves », sans rien savoir de l’histoire de cette formule. En tout cas, il n’y a rien de très original à rapprocher les films et les rêves, car il s’agit d’une idée aussi ancienne que le cinéma lui-même. Il suffit de penser aux propos très précocement posés par Jean Epstein (1947) ou René Clair (1951). L’expression « usine de rêves » n’est pas étrangère à cette liaison déjà très courante dans les années 1930, lorsque Ilya Ehrenburg (1931) l’a rendue célèbre par son livre sur l’industrie cinématographique nord-américaine. Mais, justement, Ehrenburg n’avance la formule que pour dire, non pas que les films sont comme des rêves ou que le cinéma fabrique des rêves, mais que l’industrie du cinéma, Hollywood en l’occurrence, compte envahir les rêves, les homogénéiser pour mieux les contrôler, introduire un seul « rêve » à la place de tous les rêves, bref éliminer le rêve. « Les gens – aurait ainsi dit Adolph Zukor, le créateur de Paramount – veulent aussi rêver. Ils ont avec urgence besoin de quelqu’un qui leur permet de voir des beaux rêves. Et c’est précisément ce qu’on va faire : on leur fabriquera des beaux rêves, des rêves en série, des rêves amusants, à prix réduit » (Ehrenburg, 1931, p. 25) [6]. L’hypnose contre le rêve Plutôt que de soutenir un lien entre le film et le rêve, Raymond Bellour (2009) proposait à sa place de rapprocher le cinéma avec l’hypnose. Or c’est justement ce qui se joue dans cette démarche hollywoodienne visant à éliminer le rêve par l’écran : l’hypnose contre le rêve, l’élision de la subversion onirique par la domination hypnotique [7]. Pour William H. Hays, le tout premier directeur de la toute-puissante Motion Picture Association of Producers and Distributors of America – le syndicat des producteurs et des distributeurs cinématographiques nord-américains –, ainsi que l’inventeur du célèbre Code Hays à Hollywood, il fallait bien s’approprier les écrans pour magnétiser chaque spectateur qui dort dans ces salles obscures d’ici et d’ailleurs. « Il nous faut – pensait-il – savoir leur transmettre notre poésie, la poésie de l’idéal et du dollar, la poésie de la lutte pour la réussite : celle qui nous apprend que les puissants donnent les ordres et le faibles travaillent. Il est facile de programmer la journée qu’il aura tout un chacun : Restez près du tour ! Tapez sur la machine à écrire ! Calculez ces suite des chiffres ! Mais cela ne suffit pas : il nous faut programmer aussi leurs rêves. Parvenir à ce qu’ils soient jusque dans leurs rêves des citoyens conscients des États Unis » (Ehrenbourg, 1931, pp. 59-60) [8]. Et c’est, très précisément, ce pouvoir hypnotique du cinéma qui a aussi fasciné les plus grands dictateurs : Hitler, Staline, Pinochet ou encore Kim Jong-il. Pourtant, le cinéma n’est pas seulement de l’hypnose et celle-ci ne se dégage peut-être que lorsque les films sont réduit à l’extrême en pure « industrie culturelle » (Adorno & Horkheimer, 1947[1944]). Mais plusieurs films comptent, au contraire, renverser justement cette emprise, ainsi que plusieurs réalisateurs tiennent, en fait, à s’orienter dans la direction inverse, à savoir, subvertir la suggestion par le film, mobiliser le rêve contre l’hypnose. Du coup le film ne serait donc sans aucun lien avec le rêve : si le cinéma peut s’imposer comme hypnose au rêve, alors tout film n’est pas sans avoir une dimension onirique. Or, ce serait justement cette dimension que ces « autres » films compteraient mobiliser pour contrer l’effet-hypnose de l’usine cinématographique. Il y a donc bien un rapport éventuel entre rêve et cinéma. Pourtant, il n’est pas à saisir au niveau des images mais plutôt sur le plan du destin des images (Rancière, 2003). Si l’industrie de Zukor, Goldwyn, Hugenberg, Eastman et les frères Warner ne compte pas laisser aucune place au rêve et pour cela mobilise l’image contre l’image pour anéantir la subversion onirique des images, à l’autre côté il y a un cinéma « autre » qui ne remplace pas l’image par une autre image, mais qui traite les images pour bouleverser l’image aux interstices des images. Dit autrement, il n’y aurait nul parallèle entre le rêve et le cinéma qui puisse faire l’économie des procédés par lesquels l’un et l’autre traitent les images. Cela veut dire que, s’il y a un lien entre eux, celui-ci ne saurait être saisi que par l’éventuel rapport entre deux formes semblables, mais tout à fait distinctes, de travail : le travail du film et le travail du rêve. Ajoutons ici d’emblée une autre réserve : le cinéma ne peut pas simuler le rêve, se servir des procédés du travail du rêve pour faire un film tout comme l’on fait un rêve. Ce n’est pas parce que, dans Muholland Drive (2001), Lynch rend compte d’une expertise presque freudienne pour composer un film si fidèle aux procédés du travail du rêve (Letzner & Ross, 2005), qu’il faut en conclure que l’analogie entre rêve et cinéma pourrait se faire aussi à autre niveau. N’oublions pas que ce dernier film comporte, pour son réalisateur, une très forte critique de l’industrie cinématographique à Hollywood. S’il se sert du travail du rêve pour construire son film, ce n’est pas parce que le film soit du rêve, mais plutôt parce qu’il compte, par ce travail de mis en image, bouleverser l’image unique de la domination hollywoodienne (Morel, 2011) [9]. Lynch suit ici Ehrenburg. D. Lynch, Muholland Drive, 2001 Plus précisément donc, il s’agirait, à nos yeux, de rapprocher les procédés du travail du rêve et du travail du film, sans confondre l’un avec l’autre, tout comme a pu déjà le faire Thierry Kuntzel (1972 ; 1975) dans deux travaux brillants qui, publiés il y a plus de 40 ans, n’ont pas eu vraiment de suite [10]. Un travail du film qui, tout comme le travail du rêve, traite les images pour faire advenir, dans ces interstices, un réel qui subvertit les apparences. Les désirs conçus Los deseos concebidos [Les désirs conçus] [11] de Cristián Sanchez appartient à ce cinéma dont le travail du film comporte cette dimension onirique que le propre réalisateur a explicitement accordé à Raoul Ruiz où « l’art de la fugue » entraine, d’après lui, une « libération de la réalité par la puissance de rêve qu’elle cache » (Sanchez, 2002, p. 217). Resté largement méconnu du grand publique, il s’agit bien d’un film, tout à fait remarquable, tourné en 1982 par un réalisateur qui, à l’encontre du cinéma hollywoodien et de son emprise hypnotique, procède selon un traitement filmique précis et raffiné dont il maitrise parfaitement les enjeux (Sanchez, 1979, 1987, 2006-07). En ce sens, le film s’avère encore plus exemplaire dans la mesure où il est le premier de son auteur – dont la filmographie n’est pas très longue – où l’usage des moyens cinématographiques se montre pleinement déployé et réussi. Mais notre intérêt pour le film, loin de se limiter uniquement à ses procédés, touche tout aussi bien son contenu qui, malgré les premières impressions, concerne la sombre époque où il a été filmé, c’est-à-dire la dictature civique-militaire de Pinochet. Les désirs conçus raconte l’histoire de R., un adolescent qui décide de s’ouvrir avec tout son cœur à la vie. Il habite avec sa sœur chez ses oncles et, au lycée, il est au bord de l’échec scolaire. Il passe son temps à fumer du shit et il a un groupe de copains qui se fait constamment vigiler par le surveillant général. Sa sœur a décidé de partir vivre avec son compagnon et lâche son frère qui, à l’abandon, quitte aussi la maison de ses oncles pour errer d’un squat à un autre. Avec l’aide de Mansilla, le gardien de nuit, R. loge au lycée, mais il se fait coincer en train de tricher dans un examen avec ses potes. Le directeur du lycée laisse tous les autres, sauf lui, libres de charges d’accusation et ce n’est donc que lui qui reçoit la punition. À son tour, Mansilla est licenciée de son poste et conduit le garçon à dormir chez lui où il vit avec sa femme et sa fille. En pleine nuit, celles-ci vont en cachette dans la chambre d’R., en se couchent chacune de chaque côté du lui. Peu des jours après, l’ancien vigile est reproché par son épouse pour n’avoir pas du travail et se fait expulser de chez lui. R. et Mansilla arrivent alors à la maison d’Alfonso, l’un des copains du premier, et s’y installent. Un flirt érotique très singulier s’établit tout de suite entre Mansilla et la mêre d’Alonso. De son côté, R. occupe la chambre de Catalina, la cousine d’Alfonso, qui se met nue, durant la nuit, avec lui dans le lit. Ils entretiennent un rapport amoureux, mais Alfonso avait lui aussi une liaison sentimentale avec Catalina et dévient jaloux. Les deux amis se frappent, tandis que ses bagarres se mêlent à d’autres litiges où R et ses copains se disputent pour un miméographe avec une autre bande des lycéens qui viennent des milieux plus aisés. Catalina et Alfonso se remettent ensemble. R. se retrouve à nouveau seul et décide partir. Mansilla s’excuse auprès de la mère d’Alfonso : il n’a pas bien fait son travail et, donc, il part aussi avec R. Alors, dans le lycée, le protagoniste rencontre sa prof de philo qui l’invite d’aller loger chez elle. Là, il dîne avec la prof et son mari. Ce dernier profère un long discours sur le droit qui est réservé à une élite des hommes pour satisfaire ses vices et cultiver les plus délicates manières de l’enrichir. L’homme part se reposer et sa femme propose à R. de coucher ensemble. Ils se rendent donc dans une chambre, tandis que le mari les épie avec goût et la femme de ménage lui serre le cou avec une corde. R. n’arrive pas à enlever le soutien-gorge de sa maitresse, le mari proteste face à l’inexpertice et la femme de ménage continue à étrangler son patron jusqu’à ce qu’il tombe mort sous extase. Au matin, R. se cache avec le mort dans le cercueil et s’en fuit de la maison. Il arrive avec Mansilla chez son copain Moro. La mère de Moro les reçoit et remarque son intérêt pour la propreté et l’ordre. A la maison, il y a une fille en habit d’écolier. Elle prend soin d’un aveugle qui la contrôle de manière stricte. À nouveau, Mansilla flirte avec la patronne. Cette fois-ci aucune femme ne se glisse dans le lit de R. La fille se montre conquise par R, mais elle ne prend aucune initiative et reste dans un flirt innocent, en se laissant désirer. Mansilla se sent attiré par la jeune fille et lui propose de partir ensemble. Elle garde le silence. Mansilla, Moro, R. et d’autres montent ensuite une arnaque : avec le miméographe, ils comptent falsifier des billets. La bande se réunit, planifie, discute sur ses réussites : ils parlent comme si c’était un business. Mansilla complote contre R. et propose de le laisser hors du coup. Il y aurait donc moins de gens pour se répartir les gains. Les autres résistent. Entre temps, R. continue son flirt avec la jeune fille et, finalement, il se décide. Les deux jeunes s’embrassent. Alors, Mansilla trahit tout le monde. Il s’enfuit avec le butin, kidnappe la fille et prend la fuite. R. et les autres le poursuivent, mais Mansilla réussit à leur échapper. Alors, la bande retourne à la maison où les attendent un groupe des gangsters armés. Il y a une fusillade où tous sont tués, sauf R et l’un des gangsters qui, blessé, s’évade. R. compte prolonger la quête de Mansilla et la jeune fille à travers toute la ville. Il ne les trouve pas. Il arrive dans un motel de passage. À la radio, on écoute une chanson romantique : « Soupir » de Salvatore Adamo. Des couples couchent ensemble et, soudain, deux coups de revolver se font entendre. Mansilla a tiré sur la jeune fille et s’est suicidé. R. arrive dans la chambre et trouve la jeune fille blessée à mort. Il caresse sa main et l’embrasse. Sa voix off dit : « Elle ne résistait pas. Lentement, elle se laissait aller, elle glissait… Je me suis rendu compte que je l’aimais et je la serrais dans me bras pour mourir. » Le protagoniste s’endort, puis il se réveille. « Lorsque je me suis réveillé – continue la voix off – je me souvenais de ce qui s’est passé comme si c’était un rêve. » Il embrasse la jeune fille morte et il s’en va. Il sort dans la rue. Pour la première fois, on voit la ville. Il est tôt le matin et les voitures commencent à rouler. R. marche par une rue presque vide où il y a un panneau lumineux qui dit : « Chili ». L’assujettissement au désir On le devine à ce récit, le film porte sur les dérives de l’assujettissement au désir d’un jeune garçon, désir dont les singularités sont signalées par des nombreux indices rencontrés tant sur le plan formel qu’au niveau diégétique. Certes, qu’il s’agisse du désir, cela est explicitement exprimé par le titre du film qui, de plus, s’inscrit dans un projet plus vaste du réalisateur concernant une trilogie sur le désir. Les désirs conçus en constitue le premier volet [12]. Néanmoins, dans ce titre, les désirs dont il s’agit s’avèrent conçus sans que l’on puisse vraiment savoir qui les conçoit ni à l’égard de qui sont ils conçus. Un équivoque est posé qui, de plus, s’avère redoublé par un jeu de mots. Car, en espagnol, le mot conçus [concebidos], lorsqu’il est articulé aux désirs, renvoie tout de suite au mot concédés [concedidos] dont l’écart ne tient qu’à une lettre : un b à la place d’un d. De ce fait, le titre contient une sorte de lapsus qui, réduit au différentiel minimal d’un signe, se pose à la manière d’une dyslexie ou, plutôt, d’une dysgraphie où sans doute sont évoquées les difficultés scolaires du personnage dont le nom se montre également abrégé à sa seule initiale : « R. ». Substitution donc a minima d’une unique lettre qui, sur le champ même du désir, vient placer la conception au lieu du refoulement posé sur la concession dont elle-même n´étant refoulée qu’au nom de la phrase qu’elle compose : Les désirs concédés. En effet, il s’agit là d’une expression bien plus courante que la première dont il faut dire qu’elle n’est pas du tout habituelle et même un peu forcée. Mais il est surtout question d’une formule qui, ayant la même ambiguïté que la première, contient encore plus d’équivoques. C’est, à vrai dire, l’expression très précise que le célèbre conte enfantin attribue au génie de la lampe. Face aux vœux de son maître, celui-ci lui concède ses désirs. Cela peut sembler étrange en français, mais pas du tout en espagnol où le verbe « concéder » exprime tout autant l’action d’exaucer (c’est-à-dire, accomplir, combler, contenter) que l’acte de concéder (donner, accorder, octroyer, céder). Ainsi, l’expression garde-t-elle la même imprécision que l’expression antérieure et, comme pour celle-ci, on ne sait pas qui concède, ni à qui il concède, mais cela est encore plus équivoque dans la mesure où celui qui concède le désir, comme c’est le cas du génie, se concède à ce désir et, par là, concède son désir au désir qu’il concède. Autrement dit, par sa concession, lui et son désir, deviennent objets du désir de l’Autre, aliénés dans le désir de l’Autre. Or, c’est justement de cela dont traite le film. Le protagoniste se trouve, à chaque fois, soumis au désir de l’Autre. En effet, dans tous les endroits où R. dort (et où il couche), il est toujours l’objet du désir de l’Autre : la femme et la fille de Mansilla se mettent dans son lit ; Catalina apparaît nue sous ses draps et, sans qu’il ne fasse rien du tout, elle lui dit « comme tu es terrible ! » ; la prof de philo et son mari se servent de lui pour accomplir la scène voyeuriste. En parallèle, dans chaque maison, il assiste à la satisfaction sexuelle des adultes dans des situations qu’il épie en position de voyeur mais sans excitation. Ces scènes sont parfois assez étranges, c’est-à-dire qu’elles lui sont étrangères, comme c’est exemplairement le cas des rencontres nocturnes de Mansilla et de la mère d’Alfonso, personnages qui, en plus de convoquer de manière quelque peu fétichiste des pieds et des chaussures, entretiennent des rapports à connotation sadomasochiste où l’un reste figé avec deux pierres dans ses mains et l’autre se promène somnambule. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 À vrai dire, c’est seulement dans trois occasions que le protagoniste se montre agit par son désir : au tout début, où il écrit dans un cahier pour exprimer son propos désespéré –dit-il – de s’ouvrir à la vie avec toutes ses forces ; un peu après, lorsqu’en cachette il regarde sa sœur se déshabiller et, coupable, il ressent –précise-t-il– que quelque chose s’était brisée entre eux; et, tout à la fin, quand après s’être décidé à s’engager envers la jeune fille, il se rend compte qu’il l’aimait alors qu’elle était en train de mourir. Significativement, ces trois instants sont, très précisément, tous marqués par l’apparition du récit de R. en voix off. Il faut souligner que le film n’utilise ce moyen filmique que pour ces trois moments spécifiques. Au fond, l’utilisation du procédé technique semble bien représenter une indication, sur le plan formel, de l’inflexion survenue chez le protagoniste d’une subjectivation du désir où R. laisse fugacement place dans le dire (subjonctif) au désir que j’erre. En ce sens, il faudrait observer d’une manière plus précise que ce qui, dans le film, s’avère pris par le désir de l’Autre, ce n’est pas tant le sujet devenue un pur objet pour l’Autre mais plutôt le désir du sujet aliéné au désir de l’Autre. Ainsi, les désirs conçus du film ne sont pas uniquement les désirs que l’Autre conçoit à l’égard du sujet pris comme pur objet de ses caprices, mais les désirs conçus par le sujet en fonction des désirs qu’il conçoit à la place de l’Autre. Néanmoins, tant que cette conception du désir vient à la place du refoulement de la concession du désir, alors le sujet ne conçoit les désirs de l’Autre qu’en lui concédant les désirs et, par là, il lui concède son propre désir. Autrement dit, le film dessine la course du protagoniste à l’égard du désir qui trace son transite de l’exaspération à l’assomption en passant par la culpabilité, mais qui, pour cela, il doit se confronter à son aliénation dans le désir de l’Autre où il est jeté à l’errance. Or, cette errance du sujet dans le désir ou bien plutôt, l’errance du désir dans le désir, est d’emblée signalée par le nom du personnage principal. En espagnol, tout comme en français (le réalisateur est d’ailleurs aussi francophone), la lettre R. évoque l’erre de l’errement où ça erre. Mais, l’errance est également articulée par l’architecture même du film. En effet, celui-ci procède par une dissolution de la trame centrale qui, dépourvue d’une pleine unification, se parsème de manière rhizomique dans des multiples trames secondaires. Connectées, elles répètent différemment et de forme déplacée un même motif pour configurer une trajectoire composée par la succession d’une « série d’anamorphoses » à l’instar dont Deuleuze (1985, p. 77) a caractérisé précisément le rêve. C’est d’ailleurs un trait du cinéma de Sanchez que Aburto Arenas (2006-07) avait déjà très bien saisi par rapport à l’exercice d’une approche filmique du réel qui, dans et à travers les images, fuit toujours hors du visible. En ce sens, Jorge Ruffinelli (2006-07) souligne le caractère nomade qui, dans tout l’ensemble de l’œuvre filmique du réalisateur, introduit la persistance du « hors lieu » des personnages, des situations, des actions et, encore, des films comme tels. En fait, Sanchez (2006-07) lui-même remarque non seulement l’errance de ses héros traînés à « des devenirs étranges » sous l’emprise des « forces qui les dépossèdent » et « les poussent vers un Dehors », mais également la dérive de son traitement filmique qui, « par un dédoublement du langage », poursuit le « chemin latéral ou série discontinue » (p. 159) Au fond, il s’agit bien d’une composition, tant formelle que diégétique, qui s’inspire du cinéma de Ruiz dont Sanchez (1990b) indique son « image-temps baroque constituée par des plis, replis et dépliages » selon une « méthode rhizomatique » où les multiples détours, ramifications et « prolifération d’objets, lumière, décors, personnes » visent à saisir « la singulière différence qui les traverse dans son décentrement continu et illimité » (p. 140-1). Pourtant, le cinéma de Sanchez ne montre point le baroquisme caractéristique des films de Ruiz. Tout au contraire, les œuvres de Sanchez s’accompagnent d’un minimalisme qui diminue toute hyperbole, et où la multiplicité n’est jamais déploiement mais plutôt pliure. R. Ruiz, Los tres tristes tigres, 1968 Cette sobriété presque algébrique de l’erre du désir au désir de l’Autre fait beaucoup penser à Théorème de Pasolini (1968). En fait, toute la scène voyeuriste avec la prof de philo et son mari n’est pas sans évoquer Salo ou les 120 journées de Sodome (Pasolini, 1975). Sauf que, à la différence de ce qui se passe chez ce dernier, dans la première pièce, le désir reste tout à fait irréalisé. Mais, l’inachèvement du désir dépasse largement cette scène et se répand partout dans le film de Sanchez : la fille et la femme de Mansilla glissent dans le lit d’R., mais rien de plus n’y a lieu ; Catalina apparaît nue à côté d’R. et, même si après ils s’embrassent, rien d’autre ne se continue entre eux, tandis qu’elle se remet à nouveau avec Alfonso; R. s’autorise dans son désir envers la jeune fille mais lorsqu’il se décide, elle est kidnappée et puis tuée. Dans le film, donc, aucun passage ne laisse s’infiltrer la réalisation du désir. Néanmoins, cela n’implique nullement que jamais le désir ne s’accomplisse. L’accomplissement du désir n’a rien à faire avec sa réalisation. Lancé, en tant qu’il est concédé, à sa dérive dans le désir conçu par l’Autre, le désir ne s’accomplit pas par sa réalisation dans quelque chose d’autre. Son accomplissement n’advient que dans son dépliement par le désir [13]. Ainsi, à la fin du film, le désir d’R. voyage en ville, moins, cette fois-ci, comme errance et comme aliénation, mais plutôt à la manière d’une dérive embrasée, c’est-à-dire comme ouverture du désir à son désir. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 Le désir inachevé En ce sens, le film reprend le motif du désir inachevé que Sanchez (1984, 1990) reconnaît largement dans le cinéma de Buñuel. En fait, la scène, déjà mentionnée antérieurement, de voyeurisme a, jusque dans son traitement de la couleur, une ressemblance toute à fait buñuelienne. Il y a aussi d’autres passages où le réalisateur procède, tout comme lui-même l’observe à propos de la place des anomalies chez Buñuel (Sanchez, 2002), à l’inclusion des objets ou des situations entièrement décentrée et qui, malgré sa dissonance par rapport au contexte, ne produit aucune étrangeté, comme s’il n’y avait rien d’insolite en elle. Mais, tout comme dans le cas de Ruiz, Sanchez pousse ici même plus loin le naturalisme et, par une foncière dédramatisation de la performance des comédiens (lesquels sont, pour la plus part, des acteurs non professionnels), il opère encore une sorte de pliure mêlée d’aplatissement qui déblaye son film de tout l’onirisme et du mélodrame typiquement présents dans le cinéma de Buñuel. L. Buñuel, Le charme discret de la bourgoisie, 1975 Cette espèce de mise à plat cinématographique, cette sorte de réduction ou de minimalisation filmique relève d’un traitement des images que le réalisateur emprunte à un troisième maître en scène dont sans doute il s’inspire foncièrement, à savoir, Robert Bresson. La rétraction dramatique des personnages, dont les affectations ne découlent que des actions, constitue très clairement un moyen qui, tout comme l’absence de psychologisme, l’aplatissement de l’espace, l’importance du montage sonore ou le rythme des plans, connecte les procédés de son film au cinématographe bressonien. En fait, lorsqu’il aborde le cinéma de Bresson, Sanchez (2006-07b) soulève des opérations filmiques qui ont aussi une place certaine dans son propre travail : la fragmentation drastique d’un bout de réel et l’arrachement de ses coordonnées usuelles, ainsi que l’aplatissement des prises et le dépouillement de leur signification, pour ainsi amplifier la capacité relative de l’image à se relier et se transformer par sa rencontre avec d’autres images. Pourtant, une fois de plus, le cinéaste chilien y ajoute des singularités qui, combinées à son particulier usage des moyens ruiziens et buñueliens, l’écartent aussi du grand – peut-être le plus grand – réalisateur français. R. Bresson, Les dames du Bois de Bologne, 1945 Bref, Les désir conçus montre bien la mise en place d’un traitement filmique des images, avec les images, par les images et entre les images où le montage, le cadrage, la composition des plans, le son, les personnages, les actions, le récit, les noms, les textes et, en général, tout l’ensemble de moyens cinématographiques s’articulent dans un travail du film qui, comme l’a très finement montré Kuntzel (1972, 1975), procède par des opérations tout à fait équivalentes, et même parfois identiques ou presque, à celles que Freud (1900) a reconnu comme le travail du rêve et c’est sans que cette communauté de moyens fasse pour autant du film un rêve ni, d’ailleurs et moins encore, l’inverse d’un rêve. Le film de Sanchez n’a aucun rêve, pas plus qu’il n’est lui-même un rêve. Il fuit même tout onirisme par un naturalisme dépourvu de tout illusionnisme, sans irréalisme ni le moindre illogisme. Cela ne l’empêche pas bien sûr admettre de l’inattendu et même de l’irréel. Néanmoins, le traitement des ces deux aspects ne se fait pas à l’écart de toute réalité, mais les présente plutôt comme un réel encore plus réel que la réalité elle-même. (Lacan, 1968). En ce sens, on pourrait dire que le réalisateur s’accorde à un réalisme radical qui, par le travail du film, déréalise la réalité hypnotique partagée à l’écran. Ainsi, à la fin du film, R. dit avoir l’impression de se réveiller d’un rêve et, sans aucune exaspération, il sort dans la rue pour enfin réaliser le propos qu’il s’était posé au tout début : s’ouvrir à la vie avec tout son cœur. De ce fait, le film simule mimer un happy ending où la réalisation finale écarterait le rêve pour achever l’hypnose. Cependant, le désir ne s’accomplit pas par sa réalisation, mais par sa dérive qui, dans une sorte de pousse-au-réel, pose plutôt l’accomplissement du désir, son désir dans le désir, bref qui subvertit l’hypnose hollywoodienne. On pourrait sans doute prolonger l’analyse du film et préciser encore plus ce désir dont nombre de coordonnées signalent qu’il est masculin. On remarquerait par exemple que l’errance de R. se déclenche avec la trahison de sa sœur, mais aussi avec celle que R. ressent avoir commis à l’égard de celle-ci en l’épiant nue. Trahison qui laisse R. dans l’abandon et qui se répète à chaque épisode pour laisser R. aux prises de la solitude dont il est dit que, lorsqu’on est jeune, elle prend sa force de la souffrance, tandis que, quand on est vieux, c’est le désir qui tient sa place en elle. On pourrait remarquer également que c’est toujours les femmes qui s’emparent du désir et cela différemment dans le cas des mères que dans celui des jeunes filles. Il faudrait souligner aussi le caractère louche de tous les hommes adultes du film, ainsi que la condition déchue et même dérisoire de l’ensemble des figures paternelles. Et, parce qu’il est bien question du désir masculin à l’adolescence, considérer finalement l’ensemble de ces éléments en relation à la tragédie satirique de Frank Wedekind (1891), L’éveil du printemps, à la lumière des commentaires que Freud (Nunberg & Federn, 1962) et Lacan (1974) ont fait à propos d’elle. Traces de la Terreur En tout cas, la dérive dans le désir d’R. ne s’accomplit pas comme un abstrait sans histoire ni territoire. En effet, aux interstices de ses images, le film rend compte des traces d’une réalité qui, même s’elle s’avère omniprésente, reste à première vue invisible. Très concrètement, il s’agit de la dictature de Pinochet qui, envahissant tout le film mais uniquement par des tous petits détails, laisse sa marque obscure par une certaine atmosphère accablante tout à fait sensible dans diverses scènes. La plus part des commentaires dédiés au cinéma de Sanchez ne manquent pas de observer des différentes formes cette emprise dictatoriale, pourtant ils ne semblent pas saisir vraiment toute son envergure ni lui accorder sa portée précise. Ainsi, Plaza (2004) signale l’allusion que, à la dictature, fait la confrontation vertical entre les jeunes et son lycée, mais l’indication s’arrête là et, littéralement, n’occupe que l’espace d’une seule ligne. À son tour, Aburto Arenas (2006-07) ne destine qu’un note en bas de page à identifier les sirènes d’alarme comme l’évocation d’une ville soumise à l’hypervigilance policière. De sa part, Cavallo (1999) souligne combien la situation dictatoriale de l’époque autoriserait une lecture politique qui néanmoins reste, d’après lui, beaucoup moins intéressante que les approches anthropologique ou esthétique du film. Seule l’analyse de Ruffinelli (2006-07) concède une place véritable à l’incidence de la dictature, ainsi qu’une fonction décisive pour le cinéma de Sanchez dont la menace de la Terreur et l’Etat d’exception l’auraient entrainé à produire un particulier langage cinématographique traversé par le « hors lieu » et le décentrage nomade. Mais si l’on suit son examen, même s’il ne s’agit pas d’une pure conjoncture, ces obscures années de plomb ne rentrerait dans le film que par des atmosphères contextuelles propices aux motifs tordus. Pourtant, elle est à toute évidence présente dans le film dont la percée politique a même alerté, à l’époque, la police secrète de Pinochet qui, comme le raconte Sanchez (Ruffinelli, 2006-07b), s’est rendue sur le plateau durant le tournage et a encore arrêté, puis interrogé, deux comédiennes de l’équipe. D’ailleurs, le propre dictateur a, peu de temps après, demandé se faire livrer une copie du film pour le visionner en privé. Approchons donc de plus près quelques-unes de ces traces, parfois très fugaces, concernant la si sombre période de l’histoire chilienne. Tout d’abord, il y a l’observation permanente des étudiants au lycée par le surveillant général qui arrive même à fouiller les vêtements des jeunes à l’instar d’un flic. Plus généralement, les jeunes sont toujours suspectés et ceci renvoie à deux traits du temps de la dictature : tout d’abord, à la figure légale de la détention par soupçon qui permettait à la police d’arrêter une personne (pour la plupart, des jeunes) avec le seul motif qu’il lui semblait suspecte au flic ; et, d’autre part, au changement survenu, pendant la dictature, des attributs de la jeunesse qui, ayant été auparavant l’espoir de la société, était en passe de devenir l’une des figures antisociales par excellence (de drogués, de vicieux, de transgresseurs, de subversifs). Mais la surveillance s’étend, dans le film, bien au-delà, tout le monde épiant en réalité tout le monde, ce qui évoque la méfiance générale semée par la dictature en raison de la peur d’être dénoncé aux autorités ou d’être arrêté par la police sécrète. Cette dernière est d’ailleurs montrée dans la mesure où les gangsters qui tuent les membres de la bande d’R. sont bizarrement habillés en costume, tout comme les agents de la police sécrète et, de plus, ils conduisent une Peugeot 504, c’est-à-dire l’une des voitures les plus couramment utilisées à l’époque par ces sinistres fonctionnaires. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 Autre élément très indicatif de la dictature dans le film c’est la dispute pour le miméographe qui oppose deux groupes de jeunes bien différenciés. L’un réunit des jeunes dont les peaux s’avèrent plus blanches, les cheveux clairs coupés à la Petit Prince, l’accent fort occlusif et les vêtements très bien rangés, c’est à dire un groupe de milieu aisé et bien accordé à l’ordre. Quant à l’autre, celui d’R. et ses amis, est intégré par des lycéens à l’apparence moins favorisé, à la peaux brunâtre, avec cheveux noircis, les vêtement désordonnées et des habitudes plus transgressives. Différence donc de classe, mais différence aussi de la faveur donnée par l’autorité lycéenne aux uns et pas du tout aux autre. Il s’agit au fond d’une dispute où il se dessine la profonde division introduite par la dictature dans la société chilienne, alors que le miméographe était à cette période un très précieux outil de résistance car il servait à faire les pamphlets que l’on lançait à la rue durant les manifestations. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 De plus, le directeur du lycée soutient explicitement des propos presque calqués sur des expressions de Pinochet lui-même : « Vous avez besoin d’une main ferme, une main dure, une autorité – dit-il par exemple aux étudiants. Qu’il vous fasse respecter l’ordre, la propreté, l’hygiène. [Ce sont des valeurs]. Dans le sens moral du mot » D’ailleurs, ces valeurs gravitant largement autour de toute la discipline militaire, rejoignent le projet tout à fait hygiéniste qui, avec ses différentes métaphores biologiques, a bien soutenu le pouvoir dictatorial et le dictateur lui-même (Leyton, 2015), Commandant en Chef de l’Armée chilienne, comme si le mot d’ordre ou le rappel à l’ordre pouvaient maintenir l’ordre en accord avec ses ordres. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 Les propos exprimés par le directeur du lycée vont jusqu’à imposer à R. une sanction aussi capricieuse que parlante. Parce que R. se moque des règlements et n’a aucun respect pour eux, dit le directeur, alors il sera puni en étant suspendu pour le reste de l’année, bien qu’on lui concède la grâce de continuer d’assister aux cours et de rendre même les devoirs, de participer aux examens. Il sera donc effacé de tous les registres du lycée, ajoute le proviseur qui dicte ensuite son jugement : « Tu es légalement mort ». Comme le signale le réalisateur [14], il s’agit là d’une sentence qui fait référence à l’absurde loi bureaucratique qui apparaît dans Le procès de Kafka (1925), là où le protagoniste porte, tout comme R., un nom qui ne tient qu’à une seule lettre : « K. » Pourtant, un tel châtiment montre aussi un curieux visage qui ne peut pas ne pas évoquer le plus grossier alibi de la dictature pour nier sa machine assassine lorsque, avec la connivence du pouvoir judiciaire, il était avancé qu’un disparu n’était pas décédé, c’est-à-dire tué, parce qu’il n’avait pas un corps qui puise légalement sanctionner sa mort et donc il vive sûrement ailleurs. En ce sens, à l’égard des disparus, la dictature exhortait les mêmes termes que le directeur avait convoqué pour punir R. Certes, les termes ne sont pas identiquement articulés dans les deux cas, mais il en reste que l’articulation pour les premiers n’est que l’inverse parfait de l’articulation pour le deuxième. De plus, tant pour les uns que pour l’autre, le résultat est largement semblable dans la mesure où il porte à tous au même statut paradoxal d’être morts néanmoins encore en vie. Quoi qu’il en soit, à l’égard des disparus, la mort n’était qu’une affaire de registres dont les agents de l’Etat se sont bien occupés de supprimer les abattus de tout document et, dans certain nombre non négligeable, ils se sont aussi consacrés à effacer jusqu’à les traces de toute la surface terrestre, en jetant les corps à la mer ou en les enterrant dans des niches sans registre. Finalement, comme présence spectrale de la dictature, il y a aussi la prévalence dans le film des espaces fermés, à l’intérieur des maisons, tandis que les rares espaces ouverts montrés sont tous vides ou presque. Mis à part quelques personnages, personne n’y est présent. Ceci renvoie aux couvre-feux permanents qui, imposés en dictature, obligeait les Chiliens à rester à la maison ou à squatter chez quelqu’un jusqu’au lendemain, notamment les jeunes qui, pour bénéficier d’une fête, devait la faire durer toute la nuit et attendre la levée du couvre-feu au petit matin. Mais, le privilège des espaces privés et le dépeuplement des espaces publics sont aussi ce que la Terreur a imposé aux manières quotidiennes de vivre et d’occuper l’espace [15]. La menace des agents de la dictature, la méfiance consécutive envers tout un chacun pouvant être issu de la police secrète ou bien être un simple mouchard (et cela même malgré lui), la propagande visant, avec la complicité de la presse loyale au régime, à montrer les dangers que représentaient les opposants subversifs (terroristes, disait-on déjà à l’époque) : tout cela est amené à prendre refuge dans le privé, à se clore de la société et à se retirer de l’espace public laissé uniquement pour la circulation. Ainsi, lorsqu’à la dernière image du film, apparaît enfin la ville, celle-ci est vide (ou presque) et le panneau lumineux qui vient avec cette image devient totalement ironique : voilà le Chili, un pays vidé, un territoire abandonné, laissé uniquement au seul transit. C. Sánchez, Los deseos concebidos, 1982 Enfin : contrer la tyrannie hypnotique. N’apparaissant en conséquence que par des petits bouts, la dictature prend donc place dans le film sous les emprises de la censure. On peut très bien le comprendre : c’était la même dictature qui exigeait la censure qui ne pouvait pas être défiée sans s’exposer à la mort et donc à recevoir la même punition conférée à R. Pourtant, à toute évidence, il s’agit également et surtout du contexte où il se déploie, en fait, l’errements – l’R aimant – du désir dont on vient de largement parler. En effet, ce désir dans le désir ne saurait nullement être étranger à son milieu temporel et territorial. La petite histoire d’R. n’est pas sans rapport avec la grande histoire chilienne. Car si, à la fin, R. risque son désir à la dérive du désir dans la ville vide, ce de quoi il s’agit n’est autre chose que de la subversion, au moyen du réel du désir, de l’hypnose réalisée dans l’écran de la Terreur et montée par la dictature au Chili. L’hypnose qui, pour tous les chiliens, a borné leurs désirs à l’espace privé et permis de les réaliser en toute intimité sans vraiment les accomplir. Mais, briser l’écran hypnotique de la terreur dictatoriale, laquelle rôde encore et nous fait, tout comme avant, coller à l’hypnose d’une réalité parsemée des dangers, des vulnérabilités et des risques. Briser, donc, cet écran hypnotique, ceci se fait tout comme finit par le faire R., lorsqu’il entraine le désir à la dérive du désir pour, malgré les risques encourus, sortir ce désir de sa réalisation confinée au privé, pour l’accomplir dans l’espace politique du social. Il s’agit au fond de ce que, à nous yeux, ont justement fait, en 2006 et en 2011, des jeunes tels que R. : les étudiants chiliens qui se sont mobilisés pour contrer l’écran qui maintenait, et continue à maintenir, touts les chiliens magnétisés. Malheureusement, le magnétiseur néolibéral s’est repris beaucoup trop vite… Références bibliographiques Aburto Arenas, F. (2006-07). Afuera del filme: errancia, minoría y des(autor)ización en el cine de Cristián Sánchez. Nuevo texto crítico, 19-20(37-40) : 93-107 ;
doi : 10.1353/ntc.2006.0021. Adorno, Th. & Horkheimer, M. (1947[1944]). Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid : Trotta, 1998. Allendy, R. (1927). La valeur psychologique de l’image. In P. MacOrlan, A. Beugler, C. Dullin et R. Allendy (eds.), L’art cinématographique (pp. 75–103). Paris : Libraire Félix Alcan Bellour, R. (2009). Le corps du cinéma : hypnoses, émotions, animalités. Paris : P.O.L.. Benjamin, W. (1955 [1939]). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. In W. Benjamin, Discursos interrumpidos I (pp. 15-57). Bs. Aires : Taurus, 1989. Boudry, J.-L. (1978). L’effet cinéma. Paris : Éditions Albatros. Cavallo, A. (1999). El mundo secreto del secuestro. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 291-295 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0005. Checchia, M. (2015). Poder e política na clínica psicanalítica. Sao Paulo : Annablume. Civitarese, G. (2013). Le rêve nécessaire. Nouvelles théories et nouvelles techniques de l’interprétation en psychanalyse. Paris : Ithaque, 2015. Clair, R. (1951). Réflexion faite. Paris : Gallimard. Deleuze, G. (1985). L’image-temps. Cinéma 2. Paris : Les Éditions de Minuit. Eberwein, R. T. (1984). Film and the Dream Screen: a sleep and a forgetting. Princeton, NJ : Princeton Univ. Press. Ehrenburg, I. (1931). La fábrica de sueños. Barcelona : Melusina, 2008. Epstein, J. (1947). Le cinéma du diable. Paris : Melot. Farges, J. (1975). L’image d’un corps. Communications, 23 : 88-95 ; doi : 10.3406/comm.1975.1351. Freud, S. (1889). Reseña de August Forel, Der Hypnotismus. In S. Freud, Obras completas (vol. 1, pp. 95-110). Bs. Aires : Amorrortu, 1991. Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. In S. Freud, Obras completas (vols. 4-5). Bs. Aires : Amorrortu, 1991. Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. In S. Freud, Obras completas (vol. 18, pp. 63-136). Bs. Aires : Amorrortu, 1992. Freud, S. (1925). Lettre à Ferenczi du 14 août 1925. In S. Freud et S. Ferenczi, Correspondance 1920-1933. Les années douloureuses. Paris : Calmann- Levy, 2000. Gabbard, G. O. (2001). Psychoanalysis and film. London, New York : Karnac. Gay, P. (1988). Freud. Una vida de nuestro tiempo. Bs. Aires : Paidós, 1990. Hughes, C. J. P. (1930). Dreams and films. In J. Donald, A. Friedberg et L. Marcus (eds.), Close Up 1927-1933. Cinema and modernism (pp. 260-262). Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, 1998. Kafka, F. (1925). El proceso. Madrid : Alianza Editorial, 2013. Kawin, B. F. (1978). Mindscreen: Bergman, Godard, and first-person film. Princeton, NJ : Princeton Univ. Press. Kuntzel, T. (1972). Le travail du film. Communications, 19 : 25-39 ; doi : 10.3406/comm.1972.1279. Kuntzel, T. (1975). Le travail du film, 2. Communications, 23 : 136-189 ; doi : 10.3406/comm.1975.1355. Lacan, J. (1968). La psychanalyse dans ses rapports à la réalité. In J. Lacan, Autres écrits (pp. 351-59). Paris : Seuil, 2001. Lébovici, S. (1949). Psychanalyse et cinéma. Revue internationale de filmologie, 2(5) : 49-56. Lechner, N. (1982). La lucha por el orden. In N. Lechner, Obras escogidas 1 (pp. 275-293). Santiago : LOM, 2006. Lentzner, J. R. et Ross, D. R. (2005). The dreams that blister sleep : latent content and cinematic form in Mulholland Drive. American Imago, 62(1) : 101-123 ; doi : 10.1353/aim.2005.0016. Leyton, C. (2015). Geopolítica y ciudad gueto: erradicaciones eugenésicas en la dictadura militar: Santiago de Chile 1973-1990. In R. Aceituno et R. Valenzuela, Golpe 2013-1973 (pp. 190-212). Santiago : El Buen Aire. Marinelli, L. (2006). Screening wish theories : dream psychologies and early cinema. Science in context, 19 : 87-110 ; doi : 10.1017/S0269889705000773. Martin, M. (2012). La poétique du rêve du point de vue d’une théorie des effets. Autour d’une configuration originaire. In M. Martin et L. Schifano (dirs.), Rêve et cinéma : mouvances théoriques autour d’un champ créatif (pp. 63-85). Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre ; doi : 10.4000/books.pupo.3493. Metz, C. (1975). Le film de fiction et son spectateur. Communications, 23 : 108-135 ; doi : 10.3406/comm.1975.1354. Metz, C. (1977). Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma. Paris : Bourgois, 2002. Michel, R. (2010-11). Dumme Dinge : Freud cinéphobe ?. Savoirs et clinique, 12 : 58-68 ;
doi : 10.3917/sc.012.0058. Mitry, J. (1963). Esthétique et psychologie du cinéma. Paris : Editions du Cerf, 2009. Morel, G. (2011). « This is the girl ». Sobre Mulholland Dirve (2001), de David Lynch. In G. Morel, Pantallas y sueños. Ensayos psicoanalíticos sobre la imagen en movimiento (pp. 55-75). Barcelona : Ediciones S&P. Morin, E. (1956). Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie. Paris : Les éditions de Minuit, 1978. Moulian. T. (1997). Chile actual : anatomía de un mito. Santiago : LOM, 2002. Nunberg, H. et Federn, E. (eds.) (1962). Las reuniones de los miércoles. Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Volumen 1: 1906-1908. Bs. Aires : Nueva Visión, 1979. Plaza, V. (2004). Sobre Los Deseos Concebidos. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 297-308 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0012. Radiszcz, E. (2005). Corte del ojo y montaje de la mirada. Anotaciones sobre « Un perro andaluz » de Luis Buñuel. Actualidad Psicológica, Enero, 4(32) : 2-7. Rancière, J. (2003). Le destin des images. Paris : La Fabrique. Rodriguez, A. (1983). Cómo gobernar las ciudades o principados que se regían por sus propias leyes antes de ser ocupados. In A. Rodriguez et P. Rodriguez (eds.), Santiago, una ciudad neoliberal (pp. 81-109). Quito : OLACCHI, 2009. Ruffinelli, J. (2006-07). El cine nómada: el « fuera de lugar » en la obra de Cristián Sánchez. Nuevo texto crítico, 19-20(37-40) : 15-42 ;
doi : 10.1353/ntc.2006.0007. Ruffinelli, J. (2006-07b). El deseo de desear: diálogo con Cristián Sánchez. Nuevo texto crítico, 19-20(37-40) : 43-91 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0014. Saalschutz, L. (1929). The film in its relation to the unconscious. In J. Donald, A. Friedberg et L. Marcus (eds.), Close Up 1927-1933. Cinema and modernism (pp. 256-260). Princeton, NJ : Princeton University Press, 1998. Sachs, H. (1928). Film psychology. In J. Donald, A. Friedberg et L. Marcus (eds.), Close Up 1927-1933. Cinema and modernism (pp. 252-254). Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, 1998. Sanchez, C. (1979). El trabajo del filme. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 225-228 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0010. Sanchez, C. (1987). Pourquoi filmez vous? Nuevo texto crítico, 19-20(37-40) : 223-224 ;
doi : 10.1353/ntc.2006.0003. Sanchez, C. (1990). El discreto encanto de la burguesía. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 133-135 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0002. Sánchez, C. (1990b). Las tres coronas del marinero. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 139-141 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0023. Sánchez, C. (2002). El cine de Raúl Ruiz : el progreso del tiempo. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 213-218 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0034. Sanchez, C. (2002). La misteriosa transparencia de Buñuel. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 179-187 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0006. Sánchez, C. (2006-07). Aspectos fundamentales de mi cine. Nuevo texto crítico, 19-20(37-40) : 159-161 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0037; Sanchez, C. (2006-07b). El viento sopla a favor de Bresson. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 163-178 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0045. Wedeking, F. (1891). L’éveil du printemps. Tragedie enfantine. Paris : Gallimard, 1983. Wittgenstein, L. (1953). Investigaciones filosóficas. Madrid : Trotta, 2017. Wittgenstein, L. (1980). Observaciones sobre la filosofía de la psicología. México DF : Instituto de Investigaciones filosóficas UNAM, 2007. Références filmiques Bergman, I. (dir.) et Ekelund, A. (prod.) (1957). Smultronstället [film, 35mm, b/n, 91 min]. Suède : Svensk Filmindustri. Buñuel, L. (dir.) et Amérigo, F. (prod.) (1950). Los olvidados [film, 35mm, b/n, 85 min]. Méxique : Ultramar Films. Buñuel, L. (dir.) et prod.) (1929). Un chien andalou [film, 35mm, n/b, 17 min]. France : Les Grands Films Classiques. Hitchcock, A. (dir.) et Selznick (prod.), (1945). Speelbaum [film, 35mm, n/b, 111 min]. USA : Selznick International Pictures. Lynch, D. (dir.) et Edelman, P. (prod.) (2001). Mulholland Drive [film, 35mm, couleur, 147 min]. USA : The Picture Factory. Méliès, G. (dir. et prod.) (1903). Le rêve du maître de ballet [film, 35mm, b/n, 2 min]. France : Star-Film. Méliès, G. (dir. et prod.) (1904). Le rêve de l’horloger [film, 35mm, b/n, 2 min]. France : Star-Film. Pabst, G.W. (dir.) et Neumann, H (prod.) (1926). Geheimnisse einer Seele [film, b/n, 35mm, 97min]. Alemagne : Neumann-Filmproduktion. Pasolini, P. P. (dir.) et Bolognini, M. ; Rosselinni, F. (prods.) (1968). Teorema [film, 35mm, b/n, couleur, 98 min]. Italie : Aetos Produzioni Cinematografiche. Pasolini, P.P. (dir.) et Grimaldi, A. (1975). Salò o le 120 giornate di Sodoma [film, 35mm, couleur, 117 min]. Italie : Produzioni Europee Associate S.P.A. Rome ; Les Productions Artistes Associses S.A. Paris. Porter, E. S. et Fleming, G. S. (dirs. et prods.) (1903). Life of an american fireman [film, 35mm, b/n, 6 min]. USA : Edison Manufacturing Company. Porter, E. S. et MacCutcheon, W. (dirs. et prods.) (1906). The dream of a Rarebit fiend [film, 35mm, b/n, 7 min]. USA : Edison Manufacturing Company. Sanchez, C. (dir.) et Cahn, G. (prod.) (1982). Los deseos concebidos [film, 16mm, couleur, 128 min]. Chili : Foco Films. Sanchez, C. (dir.) et Duque, C. (prod.) (1994). El cumplimiento del deseo [film, 16mm, couleur, 87 min]. Chili : Nomada Producciones. Sanchez, C. (dir.) et Ferreti, P. (prod.) (2008). Tiempos Malos [film, 16mm, couleur, 140 min]. Chili : Nomada Producciones.


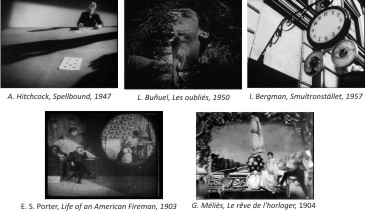

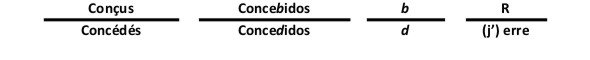










Lacan, J. (1974). Préface à L’éveil du printemps. In J. Lacan, Autres écrits (pp. 561-564). Paris : Seuil, 2001.
Sanchez, C. (1984). Ese oscuro objeto del deseo. Nuevo texto crítico, 2006-07, 19-20(37-40) : 125-128 ; doi : 10.1353/ntc.2006.0018.
NOTAS
[1] Il est bien sûr question de ce que Joël Farges (1975) avait remarqué, à fort juste titre, dans un texte dont nous n’avons pris notice que long temps après.
[2] Le rapprochement a été, en fait, très précocement formulé chez les psychanalystes, vers la fin des années 1920, par René Allendy (1927), Hans Sachs (1928), L. Saalschutz (1929) et Pennethorne Hughes (1930).
[3] Il est évidement question des perspectives qui, sous une forte influence de la psychanalyse, ont été soutenues par Christian Metz (1977) ou par Jean-Louis Boudry (1978). Néanmoins, il est aussi le cas des précédentes approches, moins psychanalytiques, de Edgar Morin (1956) et de Jean Mitry (1963).
[4] Depuis 1940, le nombre d’approches psychanalytiques posant une articulation entre cinéma et rêve n’a pas cessé de s’accroître. C’était bien le cas pour les travaux de Serge Lébovici (1949), Bruce Kawin (1978) et Robert Eberwein (1984). Mais c’est également la situation d’autres textes plus récemment recueillis par Glen Gabbard (2001), ainsi que de la position implicite aux actuels propos de Guiseppe Civitarese (2013) sur le rêve.
[5] À l’exception d’un très fugace commentaire de Christian Metz (1975) sur « les séquences de rêves » des « films narratifs » que, étant selon lui « presque toujours si peu crédibles » (p. 121), il semble m’avoir largement fourni un point d’ancrage pour mon souvenir-écran.
[6] La traduction est à nous.
[7] Tel que Marcelo Chechia (2015) l’a démontré à fort juste titre, aucune discussion sur l’hypnose ne saurait être divorcée de la dimension politique qu’elle a très exactement chez Freud. En effet, la critique freudienne de l’hypnose touche ouvertement à sa forme spécifique d’exercice du pouvoir lorsqu’elle souligne combien « la suggestion » peut entrainer « l’étouffement de la livre personnalité par le médecin qui […] détient le pouvoir de guider le cerveau dormant » (Freud, 1889, p. 102). Or, c’est bien contre cette « tyrannie de la suggestion » (Freud, 1921, p. 85) que, comme l’a remarqué Checchia, Freud (1900) s’incline vers le pouvoir de la parole impliqué dans l’association libre dont, justement, le rêve réclame pour son interprétation (pp. 122-125).
[8] La traduction est à nous.
[9] Morel, G. (2011). « This is the girl ». Sobre Mulholland Dirve (2001), de David Lynch. In G. Morel, Pantallas y sueños. Ensayos psicoanalíticos sobre la imagen en movimiento (pp. 55-75). Barcelona: Ediciones S&P.
[10] Bien que la suggestive reprise, dernièrement proposée par Marie Martin (2012) par sa notion de « effet-rêve », est d’ailleurs intéressante et, sur quelques égards, ne s’avère pas trop éloignée des nos propres orientations.
[11] Pour accéder à une version en espagnol non sous-titrée du film, on peut visiter les sites : http://www.arcoiris.tv/scheda/es/1199/ ou https://www.youtube.com/watch?v=F1TS6WgLC7o
[12] Les deux autres films de la trilogie sont L’acomplissement du désir (1994) et Temps mauvais (2008).
[13] Tout au contraire, bien que dans le même sens, lors du deuxième volet de la trilogie de Sanchez, la réalisation du désir devient justement l’impossibilité même de son accomplissement.
[14] C. Sanchez, communication personnelle, 21 septembre 2017.
[15] Tel qu’il a été observé par, entre autres, Norbert Lechner (1982), Alfredo Rodriguez (1983) y Tomás Moulian (1997) la violence d’Etat dans la dictature a promue un abandon des espaces publiques à la faveur du retrait vers l’enclos familial du foyer qui, à l’encontre des exploits de l’action collective durant la période d’Allende, est entraîné la désertification progressive des lieux communs et la privatisation généralisée des relations sociales dont la machine néoliberale a bien profité pour spolier à la ville son territoire de partage et lui arracher son sphère citoyenne grâce aux mâchoires déprédateurs du marché immobilière.



